
Type d'événement
Bruckner, Symphonie no 6 / Mirga Gražinytė-Tyla
Mary Elizabeth Williams,
Pascal Bourgeois,
Lionel Sow
Formation
Chœur de Radio France
Orchestre Philharmonique de Radio France
Mirga Gražinytė-Tyla
26
avril
Vendredi
20h00
Titre
Les prochains concerts
Titre
Les prochains concerts
-
 Concert
ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho
Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0025avril2024_Orchestre National de France- 67 € -
 Concert
ConcertBruckner, Symphonie no 6 / Mirga Gražinytė-Tyla
Mirga Gražinytė-Tyla directionLe ton des Psaumes 24 de Lili Boulanger et 150 d’Anton Bruckner délivre le mot-clé de la soirée : allégresse. À l’image, d’ailleurs, des rayons qui…voirPhilharmonie de ParisVendredi 20h0026avril2024_Chœur de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs
Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirKonzerthaus, DortmundDimanche 18h0028avril2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs
Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirRosengarten, Mannheim, AllemagneLundi 20h0029avril2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertSchumann, Concerto pour violoncelle, Gražinytė-Tyla / Julia Hagen
Julia Hagen violoncelleMirga Gražinytė-Tyla directionRobert Schumann aimait s’abriter derrière ses doubles, Eusebius le mélancolique et Florestan le fougueux. Tous deux sont d’ailleurs tapis dans l’…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0030avril2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertSchumann, Concerto pour violoncelle, Gražinytė-Tyla / Julia Hagen : hors les murs
Julia Hagen violoncelleMirga Gražinytė-Tyla directionRobert Schumann aimait s’abriter derrière ses doubles, Eusebius le mélancolique et Florestan le fougueux. Tous deux sont d’ailleurs tapis dans l’…voirMusikverein, VienneJeudi 19h3002mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirKonzerthaus - VienneDimanche 19h3005mai2024_Orchestre National de France -
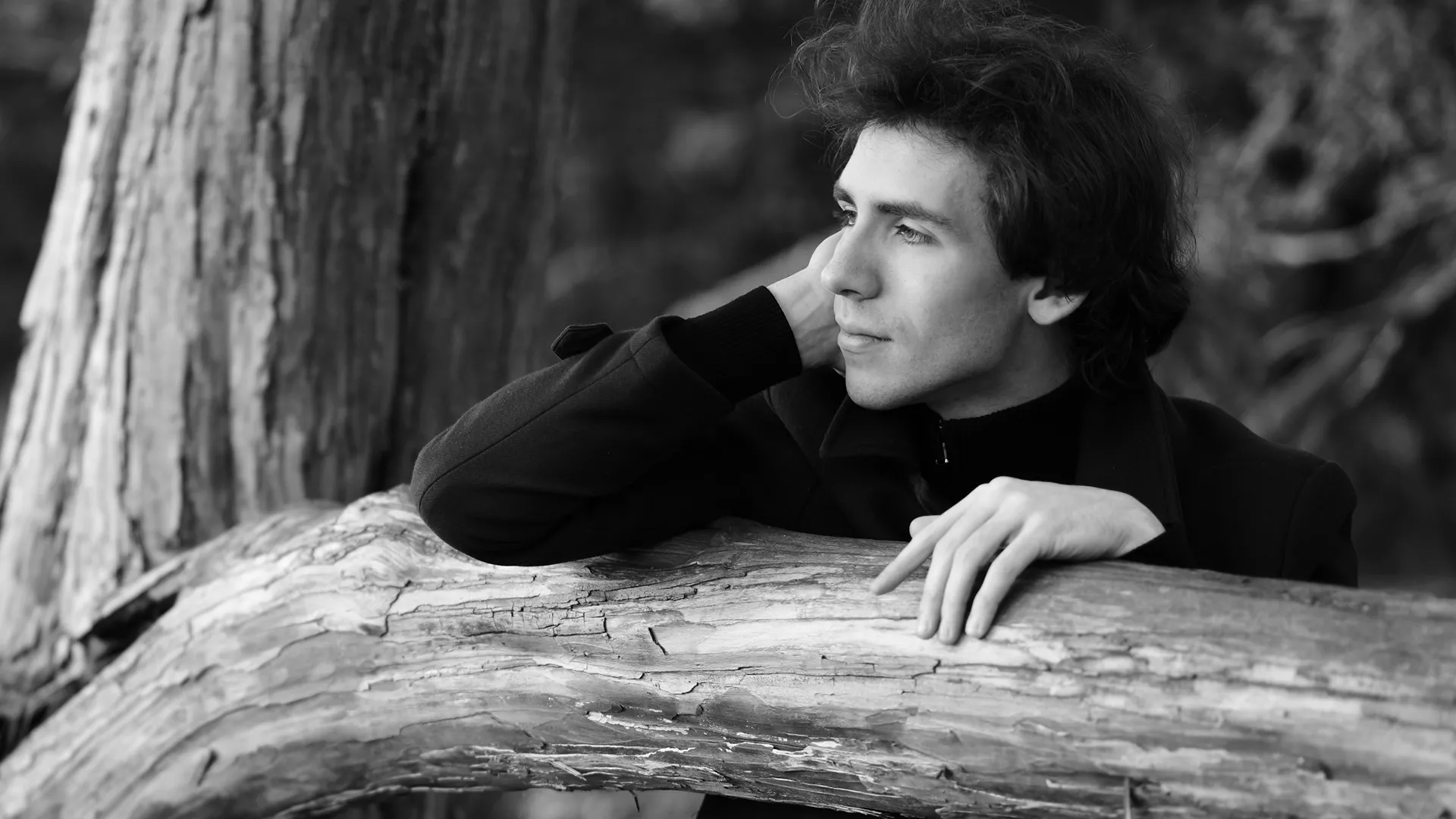 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirCongress, Innsbruck, AutricheLundi 21h0006mai2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertBach / Brahms, C.-P. La Marca / P. Christ
Christian-Pierre La Marca violoncelle , Philipp Christ orgueOrgue versus violoncelle : le souffle en renfort de l’instrument le plus proche de la voix humaine. Des pages de Johann Sebastian Bach (Suite pour…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0007mai2024__16 € -
 Concert
ConcertINA grm / Akousma #3
L’INA grm vous convie à trois soirées consacrées aux musiques acousmatiques, à la croisée des générations et des sensibilités. Oreille tendue au-delà…voirMaison de la Radio et de la Musique - Studio 104Vendredi 20h3010mai2024_- 10 € -
 Concert
ConcertINA grm / Akousma #4
L’INA grm vous convie à trois soirées consacrées aux musiques acousmatiques, à la croisée des générations et des sensibilités. Oreille tendue au-delà…voirMaison de la Radio et de la Musique - Studio 104Samedi 20h3011mai2024_- 10 € -
 Concert
ConcertINA grm / Akousma #5
L’INA grm vous convie à trois soirées consacrées aux musiques acousmatiques, à la croisée des générations et des sensibilités. Oreille tendue au-delà…voirMaison de la Radio et de la Musique - Studio 104Dimanche 18h0012mai2024_- 10 €
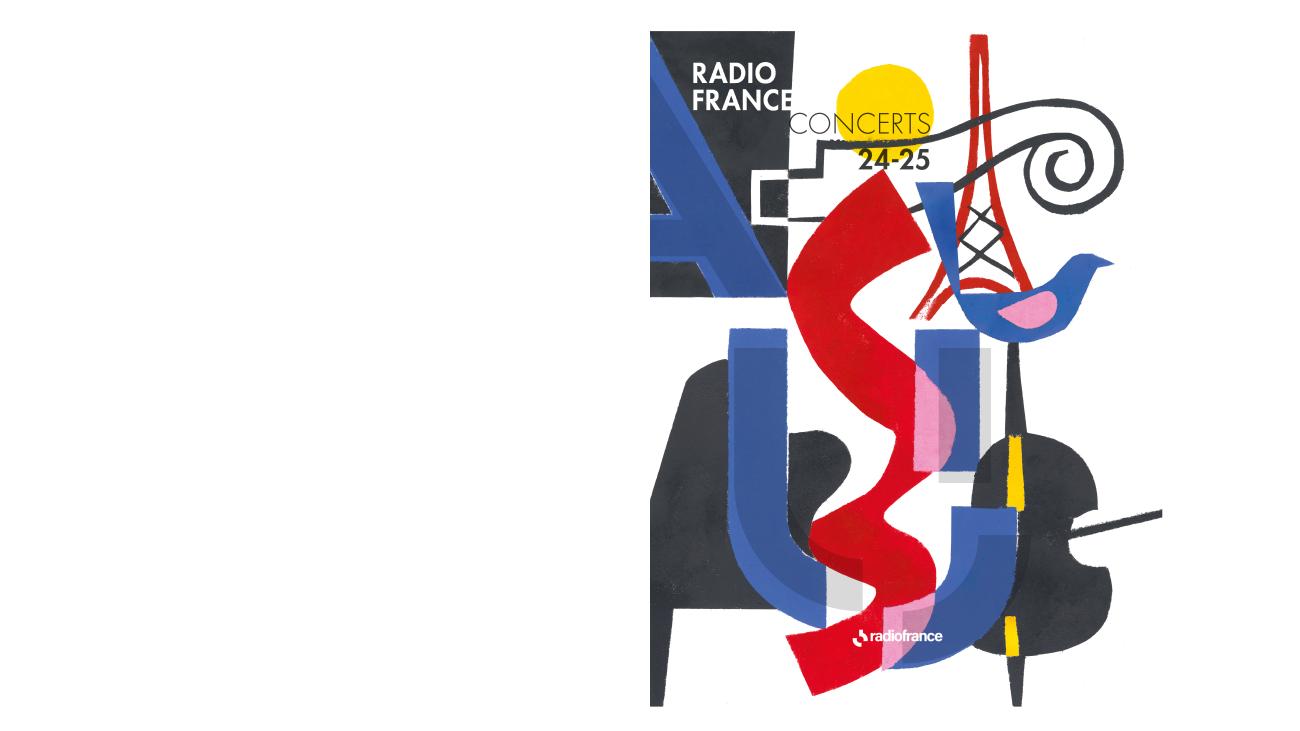
Titre
Prochains concerts à l'Auditorium
Titre
Prochains concerts à l'Auditorium
-
 Concert
ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho
Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0025avril2024_Orchestre National de France- 67 € -
 Concert
ConcertSchumann, Concerto pour violoncelle, Gražinytė-Tyla / Julia Hagen
Julia Hagen violoncelleMirga Gražinytė-Tyla directionRobert Schumann aimait s’abriter derrière ses doubles, Eusebius le mélancolique et Florestan le fougueux. Tous deux sont d’ailleurs tapis dans l’…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0030avril2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertBach / Brahms, C.-P. La Marca / P. Christ
Christian-Pierre La Marca violoncelle , Philipp Christ orgueOrgue versus violoncelle : le souffle en renfort de l’instrument le plus proche de la voix humaine. Des pages de Johann Sebastian Bach (Suite pour…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0007mai2024__16 € -
 Concert
ConcertErik Satie, Alice Sara Ott / Francesco Tristano
Alice Sara Ott piano , Francesco Tristano pianoPour un tandem inattendu, c’en est un. Alice Sara Ott et Francesco Tristano se croisent le temps d’un duel à fleurets mouchetés. À peine la première…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0014mai2024_- 47 € -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0016mai2024_Orchestre National de France- 67 € -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0017mai2024_Orchestre National de France- 67 € -
 Concert
ConcertBeethoven, « L’Empereur » / Emanuel Ax
Emanuel Ax pianoMikko Franck directionIl y a tant de répertoires qu’Emanuel Ax sert prodigieusement : en soliste, face à l’orchestre, en musique de chambre, avec ses amis Yo-Yo Ma ou hier…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0024mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertBeethoven, « L’Empereur » / Emanuel Ax
Emanuel Ax pianoMikko Franck directionIl y a tant de répertoires qu’Emanuel Ax sert prodigieusement: en soliste, face à l’orchestre, en musique de chambre, avec ses amis Yo-Yo Ma ou hier…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0024mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertViva l’Orchestra !
Emilie Munera présentationBarbara Dragan directionVoici la dixième édition parisienne de Viva l’Orchestra ! Les 105 musiciens amateurs ont répété de longues semaines avec les musiciens de l’Orchestre…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumDimanche 16h0026mai2024_Orchestre des Grands Amateurs de Radio France, Orchestre National de France -
 Concert
ConcertChopin / Brahms, Stephen Tharp
Stephan Tharp orgueL’organiste américain Stephen Tharp, très actif en Amérique du Nord, en particulier à New York, transcrit plusieurs fleurons du piano romantique,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0028mai2024__16 € -
 Concert
ConcertRavel, La Valse / Victor Julien-Laferrière
Victor Julien-Laferrière violoncelleMikko Franck directionDeux valses se renvoient la balle : laquelle est la plus macabre ? Celle dont Camille Saint-Saëns annonce la couleur, ou celle que le futur auteur du…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0031mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertPurcell / Dowland, Lea Desandre
Léa Desandre mezzo-sopranoThomas Dunford directionQuelques grappes d’accords au luth de Thomas Dunford, le timbre de rosée de Lea Desandre et la complicité d’amis musiciens : la poésie élisabéthaine…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0004juin2024_Ensemble Jupiter- 67 €
Pour aller plus loin
Ligne
Titre
Abonnements & Pass Concert

Titre
L'agenda de la saison
Titre
Bons plans

Titre
Soutenir nos activités musicales
Titre
Les prochains concerts Bach
Titre
Les prochains concerts Bach
-
 Concert
ConcertBach / Brahms, C.-P. La Marca / P. Christ
Christian-Pierre La Marca violoncelle , Philipp Christ orgueOrgue versus violoncelle : le souffle en renfort de l’instrument le plus proche de la voix humaine. Des pages de Johann Sebastian Bach (Suite pour…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0007mai2024__16 € -
 Concert
ConcertBach / Haendel, Vilde Frang
Quel plaisir d’entendre à nouveau les orchestres modernes jouer Bach et Haendel, si longtemps prés carrés des ensembles spécialisés ! Aujourd’hui,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumSamedi 20h0008juin2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertBach / Rachmaninov, Thomas Ospital
Thomas Ospital orgueThomas Ospital est un fin connaisseur de l’orgue Grenzing de Radio France, où il fut artiste en résidence entre 2016 et 2019. Bach donne le coup d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0024septembre2024_ -
 Concert
ConcertPhilhar’Intime - Bach / Leonardo García Alarcón
Quito Gato luth , Anne-Sophie Neves flûte , Cyril Ciabaud hautbois , Ana Millet violon , Rachel Givelet violon , Virginie Michel violon , Marie-Emeline Charpentier alto , Jérémie Maillard violoncelle , Étienne Durantel contre-ténorLeonardo García Alarcón clavecin et directionChef, claveciniste, inlassable défricheur, Leonardo Garcia Alarcón est l’invité régulier de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, avec qui il a…voirMaison de la Radio et de la MusiqueDimanche 16h0006octobre2024_ -
 Concert
ConcertCHORUS LINE #2 / Brahms, Bruckner - Lionel Sow / BRUCKNER 2/3
Lucile Dollat orgueLionel Sow directionTraverse-t-on l’Allemagne romantique ou la Renaissance? Dans la deuxième de ses trois grandes messes, Anton Bruckner cherche à retrouver l’esprit des…voirMaison de la Radio et de la MusiqueDimanche 16h0017novembre2024_Chœur de Radio France, Musiciens de l'Orchestre National de France -
 Concert
ConcertPhilhar’Intime / Bach, L’Art de la fugue
Antoine Tamestit alto , Virginie Buscail violon , Mathilde Klein violon , Aurore Doise violon , Sarah Khavand violon , Jean-Philippe Kuzma violon , Anne Villette violon , Yoko Ishikura violon , Martin Blondeau violon , Floriane Bonanni violon , Aurélia Souvignet-Kowalski alto , Julien Dabonneville alto , Renaud Guieu violoncelle , Catherine de Vençay violoncelle , Marta Fossas contrebasse« Qui suis-je ? » interroge, taquin, Antoine Tamestit dans sa biographie. « Musicien et altiste passionné, je joue des récitals, des concertos et de…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumDimanche 16h0024novembre2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertBach, Variations Goldberg - Les Matins du National
Jeanne Jourquin clavecin , Joséphine Poncelin de Raucourt flûte , Christelle Pochet clarinette , Marie Boichard basson , Antoine Morisot cor , Gaëlle Spieser violon , Hector Burgan violon , Louise Desjardins alto , Alexandre Giordan violoncelle , Tom Laffolay contrebasse , Saskia de Ville présentationJouer, entendre (et donc partager) Bach a toujours quelque chose de réjouissant – un célèbre chef d’orchestre a parlé de « musique au château du…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumDimanche 11h0015décembre2024_Musiciens de l'Orchestre National de France -
 Concert
ConcertBach, Préludes et fugues - Trompette et orgue
Fabien Norbert trompette , Jean-Baptiste Monnot orgueLe brillant de la trompette face aux fondus irisés de l’orgue. Les légendaires Maurice André et Marie-Claire Alain ont montré, jadis, combien le…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumDimanche 16h0022décembre2024_ -
 Concert
ConcertJohann Sebastian Bach / Jean-Luc Ho
Jean-Luc Ho orgue et clavicorde avec pédalierAu service complet de Bach. Ancien élève de Blandine Verlet, Blandine Rannou et Olivier Beaumont, Jean-Luc Ho se présente comme un « musicien de…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumSamedi 20h0018janvier2025_ -
 Concert
ConcertJohann Sebastian Bach / Notre-Dame de Paris
Lucile Boulanger viole de gambeSofi Jeannin direction , Henri Chalet directionPlus qu’un concert, un symbole. La Maîtrise de Radio France et la Maîtrise de Notre-Dame, rejointes par l’archet lumineux de Lucile Boulanger, s’…voirCathédrale Notre-Dame de ParisMardi 20h3004février2025_Maîtrise de Radio France, Maîtrise Notre-Dame de Paris -
 Concert
ConcertBach / Mendelssohn - Matthias Havinga
Matthias Havinga orgueVisionnaire, Berlioz eut un jour ce mot : « Il n’y a pas d’autre Dieu que Bach, et Mendelssohn est son prophète. » Allusion aux efforts, disons…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumSamedi 20h0022février2025_ -
 Concert
ConcertBach, Cantates / Leonardo García Alarcón
Sophie Junker soprano , Kacper Szelazek contre-ténor , Laurence Kilsby ténor , Mark Milhofer ténor , Andreas Wolf basse , Sreten Manojlovic basse , Adrià Gràcia Gàlvez orgue , Quito Gato luth , Rodney Prada viole de gambe ,Leonardo García Alarcón clavecin et directionDes cantates ? Et pourquoi pas deux miniatures d’opéras ? Dans La Controverse entre Phébus et Pan, Bach met en scène une joute divine : il s’agira,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumSamedi 20h0008mars2025_Orchestre Philharmonique de Radio France
Titre
Les prochains concerts de Mikko Franck
Titre
Les prochains concerts de Mikko Franck
-
 Concert
ConcertBeethoven, « L’Empereur » / Emanuel Ax
Emanuel Ax pianoMikko Franck directionIl y a tant de répertoires qu’Emanuel Ax sert prodigieusement : en soliste, face à l’orchestre, en musique de chambre, avec ses amis Yo-Yo Ma ou hier…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0024mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertAmaury Coeytaux / Mikko Franck : Festival du Printemps de Prague
Amaury Coeytaux violonMikko Franck direction , Kryštof Mařatka directionDans le cadre du Festival du Printemps de PraguevoirRudolfinum, Prague,République TchèqueLundi 20h0027mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertRavel, La Valse / Victor Julien-Laferrière
Victor Julien-Laferrière violoncelleMikko Franck directionDeux valses se renvoient la balle : laquelle est la plus macabre ? Celle dont Camille Saint-Saëns annonce la couleur, ou celle que le futur auteur du…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0031mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertRufus Wainwright, Dream Requiem / Mikko Franck
Mikko Franck direction"Dream Requiem" est l'amalgame de deux idées musicales et creatives, qui se sont développées côte à côte pendant longtemps et qui ont été réunies…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0014juin2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertTournée de l'Orchestre Philharmonique de Radio France en Espagne et Pays-Basque : Saint-Jean-de-Luz
Sol Gabetta violoncelleMikko Franck directionDans le cadre du Festival Ravel. ImagevoirÉglise Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-LuzJeudi 20h0029août2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertTournée de l'Orchestre Philharmonique de Radio France en Espagne et Pays-Basque : San Sebastián
Sol Gabetta violoncelleMikko Franck directionDans le cadre de la Quincena Musical. ImagevoirAuditorio El Kursaal, San SebastianVendredi 20h0030août2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertTournée de l'Orchestre Philharmonique de Radio France en Espagne et Pays-Basque : Santander
Sol Gabetta violoncelleMikko Franck directionDans le cadre du Festival International de Santander. ImagevoirPalacio Festivales, SantanderSamedi 20h0031août2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertBerlioz, Les Nuits d’été
Léa Desandre mezzo-soprano , Sofi Jeannin cheffe de chœurMikko Franck directionDes lagunes aux montagnes, n’y aurait-il qu’un pas ? Si Berlioz pousse jusqu’à l’île inconnue, dans le cycle rêveur et mélancolique des Nuits d’été,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0013septembre2024_Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertMahler, Symphonie n°3 / Mikko Franck
Mikko Franck directionUne symphonie telle un monde, et le plus démesuré. Mahler n’a pas encore déployé pareil gigantisme jusque-là : tant en termes d’effectifs, de durée…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0019septembre2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertTchaïkovski, Concerto pour violon - Hilary Hahn / Mikko Franck
Hilary Hahn violonMikko Franck directionL’orchestre crépite, Berlioz s’amuse : l’ouverture de Béatrice et Bénédict tisse un tapis multicolore au concerto qui suit, deux tableaux d’une…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0018octobre2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertTchaïkovski, Concerto pour violon - Hilary Hahn / Mikko Franck : Baden-Baden
Hilary Hahn violonMikko Franck directionL’orchestre crépite, Berlioz s’amuse : l’ouverture de Béatrice et Bénédict tisse un tapis multicolore au concerto qui suit, deux tableaux d’une…voirFestspielhaus, Baden-BadenSamedi 20h0019octobre2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertTchaïkovski, Concerto pour violon - Hilary Hahn / Mikko Franck : Luxembourg
Hilary Hahn violonMikko Franck directionL’orchestre crépite, Berlioz s’amuse : l’ouverture de Béatrice et Bénédict tisse un tapis multicolore au concerto qui suit, deux tableaux d’une…voirPhilharmonie LuxembourgDimanche 19h3020octobre2024_Orchestre Philharmonique de Radio France
Titre
Les prochains concerts de Cristian Măcelaru
Titre
Les prochains concerts de Cristian Măcelaru
-
 Concert
ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho
Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0025avril2024_Orchestre National de France- 67 € -
 Concert
ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs
Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirKonzerthaus, DortmundDimanche 18h0028avril2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs
Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirRosengarten, Mannheim, AllemagneLundi 20h0029avril2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirKonzerthaus - VienneDimanche 19h3005mai2024_Orchestre National de France -
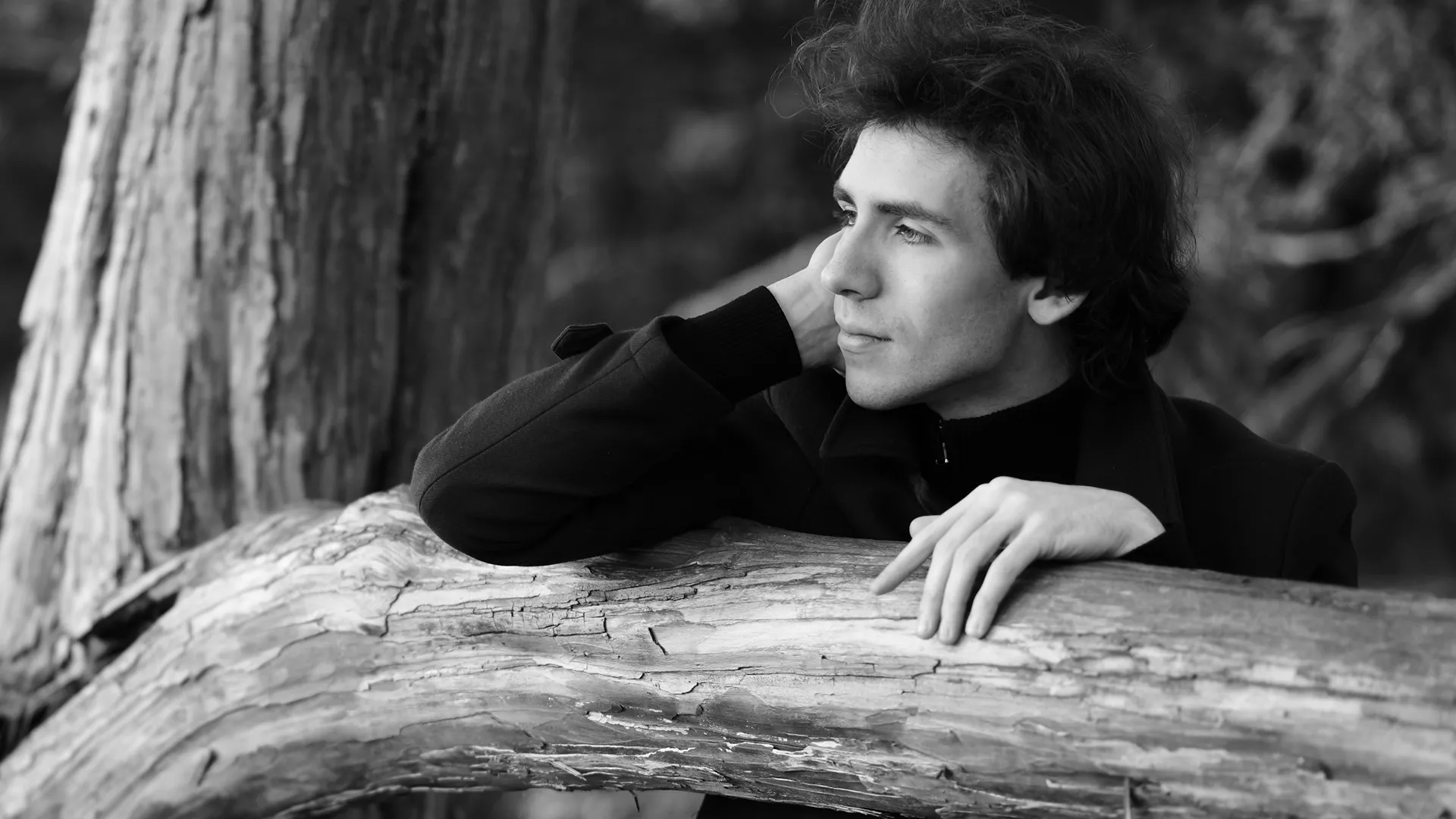 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirCongress, Innsbruck, AutricheLundi 21h0006mai2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0016mai2024_Orchestre National de France- 67 € -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0017mai2024_Orchestre National de France- 67 € -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirAuditorio – Palacio de Congresos, Saragosse, EspagneLundi 19h3020mai2024_Orchestre National de France -
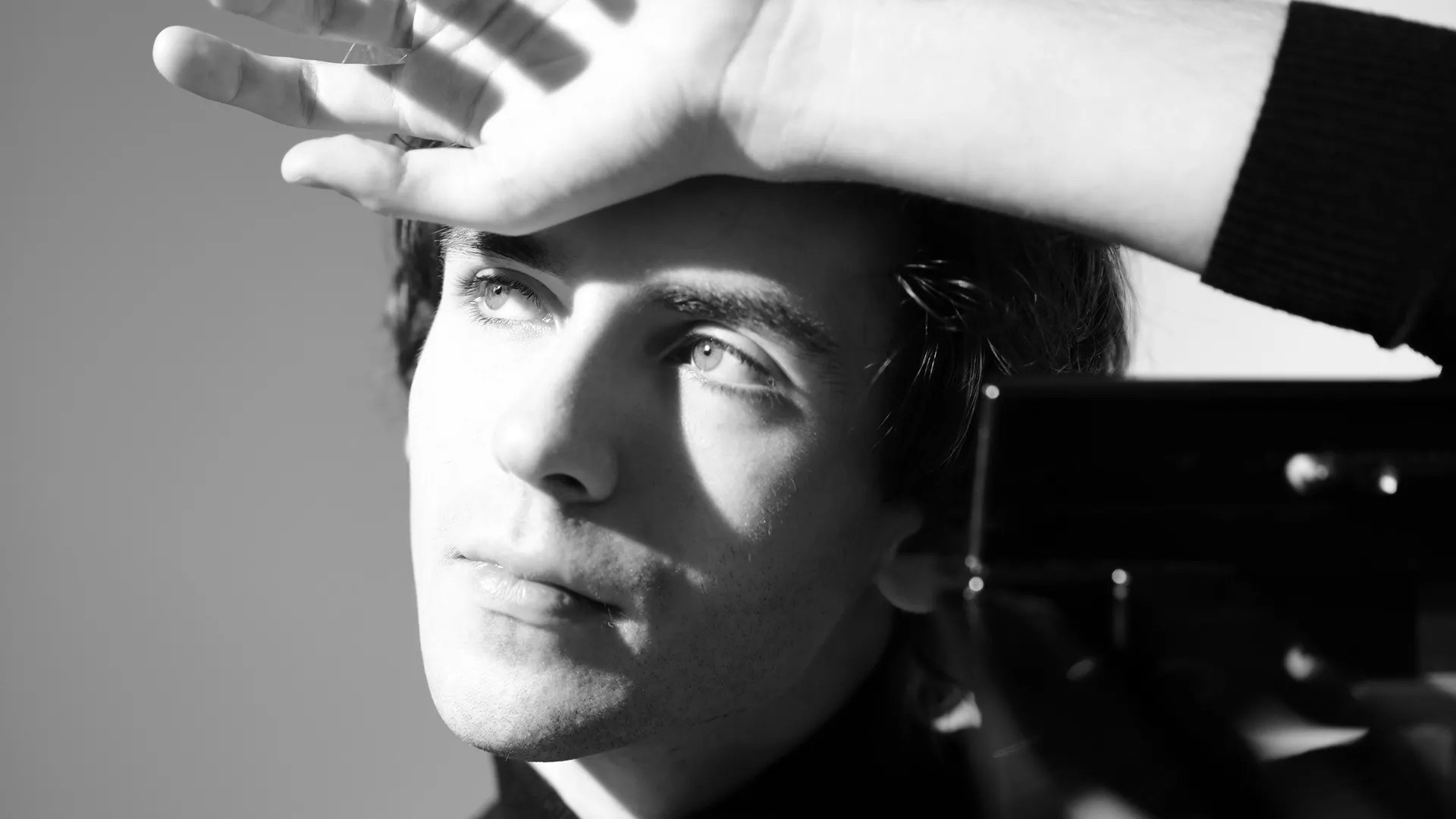 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirL'Auditori, Barcelone, EspagneMardi 20h0021mai2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirPalau de la musica, Valence, EspagneMercredi 19h3022mai2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirAuditorio Nacional, Madrid, EspagneJeudi 19h3023mai2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirAuditorio Girona, Gérone, EspagneDimanche 20h0026mai2024_Orchestre National de France
Titre
Les prochains concerts du Chœur de Radio France
Titre
Les prochains concerts du Chœur de Radio France
-
 Concert
ConcertBruckner, Symphonie no 6 / Mirga Gražinytė-Tyla
Mirga Gražinytė-Tyla directionLe ton des Psaumes 24 de Lili Boulanger et 150 d’Anton Bruckner délivre le mot-clé de la soirée : allégresse. À l’image, d’ailleurs, des rayons qui…voirPhilharmonie de ParisVendredi 20h0026avril2024_Chœur de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertRufus Wainwright, Dream Requiem / Mikko Franck
Mikko Franck direction"Dream Requiem" est l'amalgame de deux idées musicales et creatives, qui se sont développées côte à côte pendant longtemps et qui ont été réunies…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0014juin2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertANNIVERSAIRE FAURÉ 3/3
Alice Sara Ott piano , Edwin Crossley-Mercer baryton , Lucile Dollat orgue , Maria Forsström cheffe de chœurCristian Măcelaru directionNi colère ni menace. Si le Requiem de Gabriel Fauré est demeuré si populaire, c’est peut-être pour la douceur et le réconfort qu’il nous apporte. On…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0020juin2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre National de France- 67 € -
 Concert
ConcertCHORUS LINE #5
INA GRM musiques électroniquesLionel Sow directionImaginez, en plein Paris, l’immense salle ovale de la Bibliothèque Richelieu entièrement restaurée, et un programme sur mesure, usant d’une savante…voirBibliothèque nationale de FranceLundi 20h0001juillet2024_Chœur de Radio France_16 € -
 Concert
ConcertConcert de Paris
On croit que la fête est finie, mais non, en voici l’apothéose. Le rendez-vous musical le plus chaleureux de l’été parisien se déroule au pied de la…voirChamp de Mars (tour Eiffel)Dimanche 22h1514juillet2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre National de France -
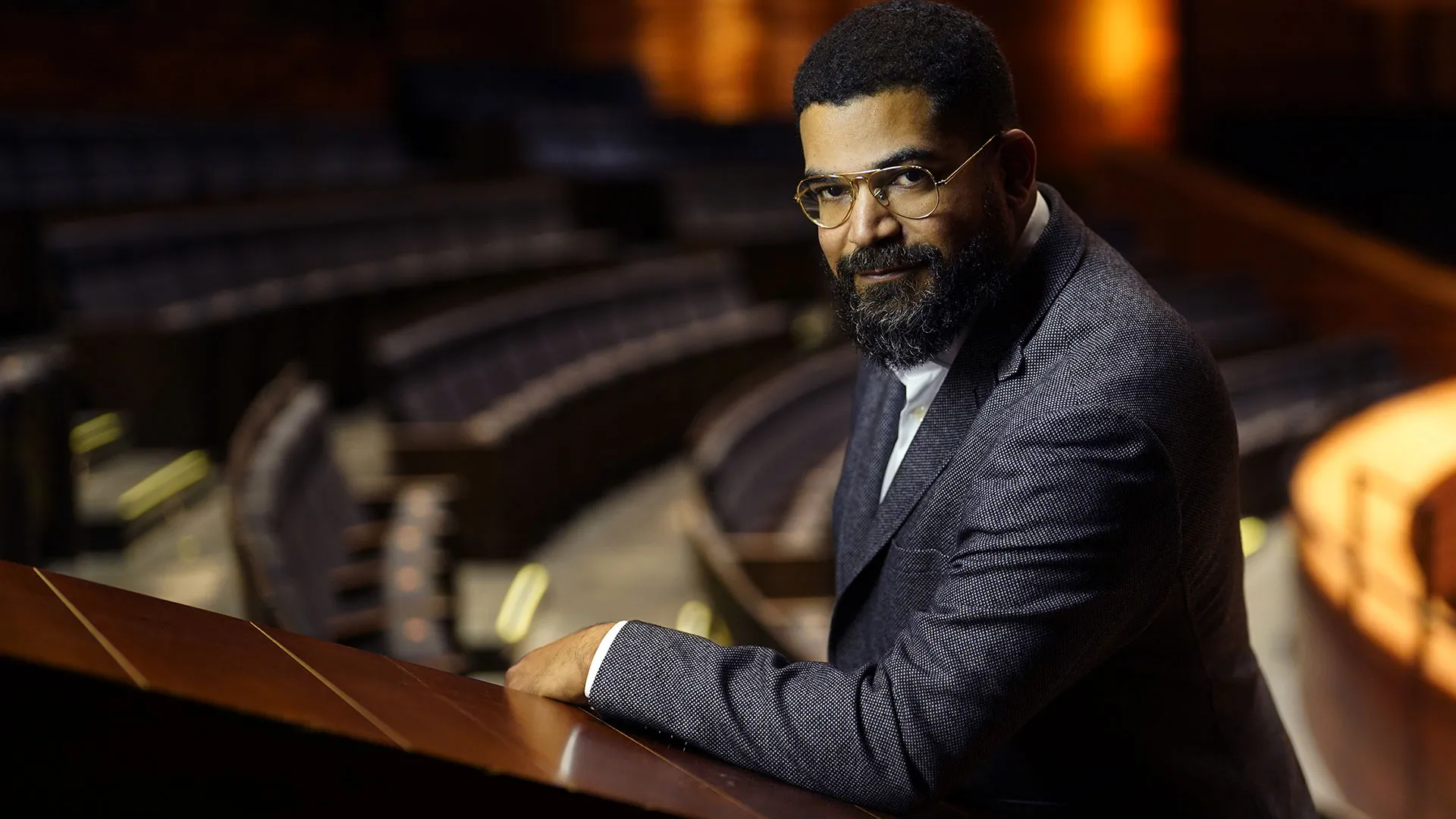 Concert
ConcertCHORUS LINE #1 / Concertos pour chœur, Lionel Sow
Lionel Sow directionLe Chœur de Radio France fait sa rentrée, en choisissant deux piliers de la musique slave, Tchaïkovski et Rachmaninov, autour desquels gravitent…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumDimanche 16h0015septembre2024_Chœur de Radio France -
 Concert
ConcertMahler, Symphonie n°3 / Mikko Franck
Mikko Franck directionUne symphonie telle un monde, et le plus démesuré. Mahler n’a pas encore déployé pareil gigantisme jusque-là : tant en termes d’effectifs, de durée…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0019septembre2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertLe Chœur de Radio France en tournée : Toulouse
Tarmo Peltokoski directionvoirHalle aux Grains, ToulouseSamedi 20h0028septembre2024_Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur de l’Opéra National du Capitole de Toulouse, Chœur de Radio France -
 Concert
ConcertRequiem de Verdi, Riccardo Muti
Juliana Grigoryan soprano , Marie-Nicole Lemieux contralto , Giovanni Sala ténor , Maharram Huseynov basse , Alessandro Di Stefano chef de chœurRiccardo Muti directionDisons-le simplement: Riccardo Muti est le plus grand chef verdien en activité. De Nabucco à Otello, l’ancien directeur de la Scala de Milan a…voirPhilharmonie de ParisVendredi 20h0004octobre2024_Chœur de Radio France, Orchestre National de France -
 Concert
ConcertBusoni, Concerto pour piano - Kirill Gerstein / Sakari Oramo
Kirill Gerstein piano , Guillemette Daboval cheffe de chœurSakari Oramo directionUn objet inclassable, une outrance, un animal fabuleux, qui ne s’apprivoise pas au premier coup d’œil et demande qu’on oublie tout préconçu: ce…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0010octobre2024_Chœur de Radio France, Orchestre National de France -
 Concert
ConcertLigeti / Stravinsky, Barbara Hannigan
Guillemette Daboval cheffe de chœurBarbara Hannigan directionPremière artiste invitée, Barbara Hannigan confronte deux géants du XXe siècle, passant de l’un et l’autre pour mieux les entendre se répondre : les…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0011octobre2024_Chœur de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertRequiem de Mozart, Lisette Oropesa / Cyrille Dubois
Lisette Oropesa soprano , Ève-Maud Hubeau mezzo-soprano , Cyrille Dubois ténor , Nahuel Di Pierro baryton , Sofi Jeannin cheffe de chœur , Lionel Sow chef de chœurBertrand de Billy directionMozart et Poulenc : ces deux-là vont bien ensemble. D’ailleurs on peut trouver des vertus mozartiennes à la musique de Francis Poulenc, dans son…voirThéâtre des Champs-ÉlyséesJeudi 20h0017octobre2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre National de France
Titre
Prochains concerts symphoniques
Titre
Prochains concerts symphoniques
-
 Concert
ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho
Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0025avril2024_Orchestre National de France- 67 € -
 Concert
ConcertBruckner, Symphonie no 6 / Mirga Gražinytė-Tyla
Mirga Gražinytė-Tyla directionLe ton des Psaumes 24 de Lili Boulanger et 150 d’Anton Bruckner délivre le mot-clé de la soirée : allégresse. À l’image, d’ailleurs, des rayons qui…voirPhilharmonie de ParisVendredi 20h0026avril2024_Chœur de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs
Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirKonzerthaus, DortmundDimanche 18h0028avril2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs
Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirRosengarten, Mannheim, AllemagneLundi 20h0029avril2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertSchumann, Concerto pour violoncelle, Gražinytė-Tyla / Julia Hagen
Julia Hagen violoncelleMirga Gražinytė-Tyla directionRobert Schumann aimait s’abriter derrière ses doubles, Eusebius le mélancolique et Florestan le fougueux. Tous deux sont d’ailleurs tapis dans l’…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0030avril2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -
 Concert
ConcertSchumann, Concerto pour violoncelle, Gražinytė-Tyla / Julia Hagen : hors les murs
Julia Hagen violoncelleMirga Gražinytė-Tyla directionRobert Schumann aimait s’abriter derrière ses doubles, Eusebius le mélancolique et Florestan le fougueux. Tous deux sont d’ailleurs tapis dans l’…voirMusikverein, VienneJeudi 19h3002mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirKonzerthaus - VienneDimanche 19h3005mai2024_Orchestre National de France -
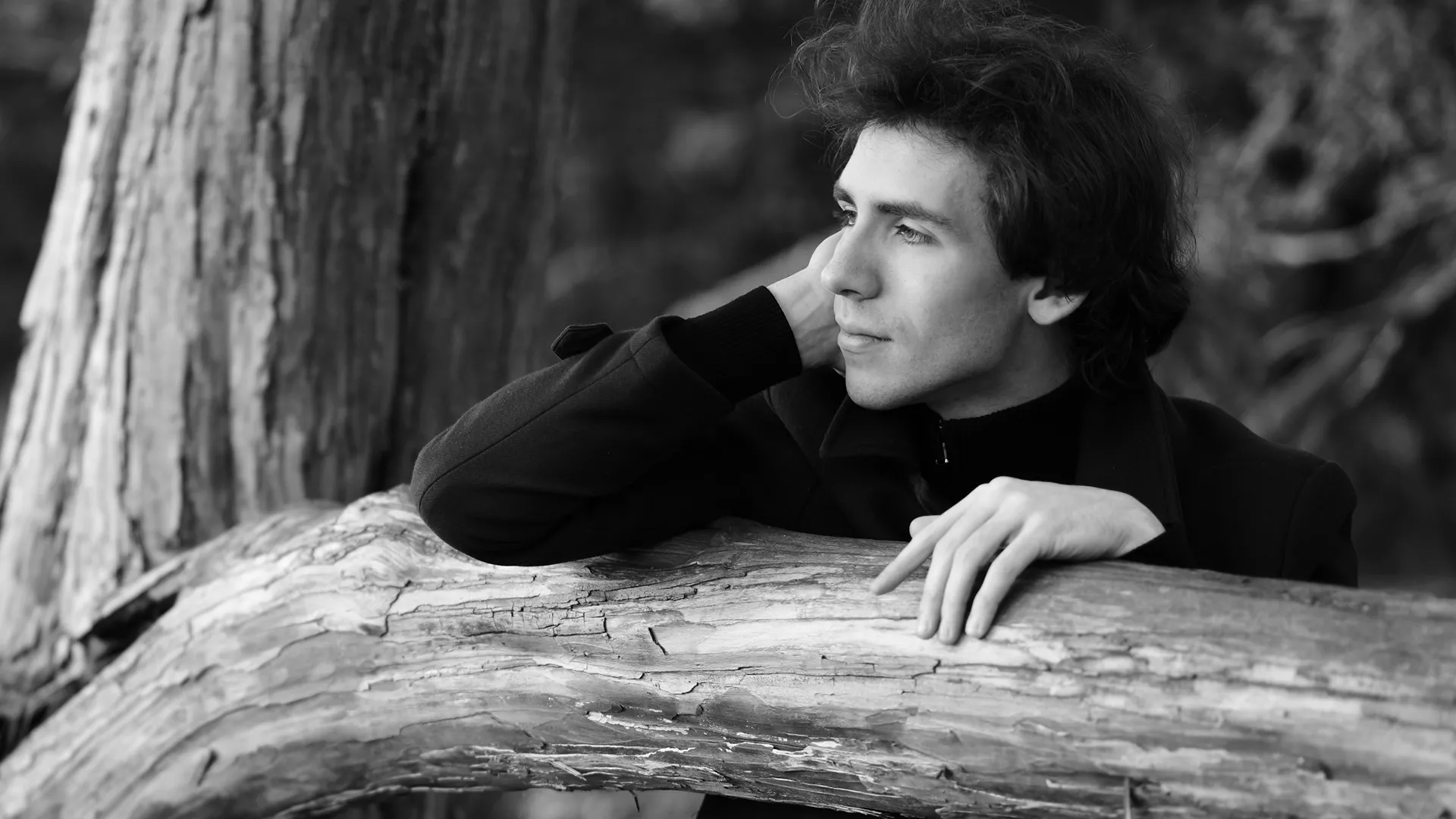 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirCongress, Innsbruck, AutricheLundi 21h0006mai2024_Orchestre National de France -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0016mai2024_Orchestre National de France- 67 € -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0017mai2024_Orchestre National de France- 67 € -
 Concert
ConcertMahler, Symphonie no 5 / Myung-Whun Chung
Myung-Whun Chung directionL’ancien directeur musical du Philhar entretient des liens étroits avec Mahler, ainsi que sa vision de la Neuvième l’a rappelé, la saison dernière.…voirPhilharmonie de ParisVendredi 20h0017mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 77 € -
 Concert
ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs
Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirAuditorio – Palacio de Congresos, Saragosse, EspagneLundi 19h3020mai2024_Orchestre National de France
Titre
Les prochains avant-concerts
Titre
Les prochains avant-concerts
-
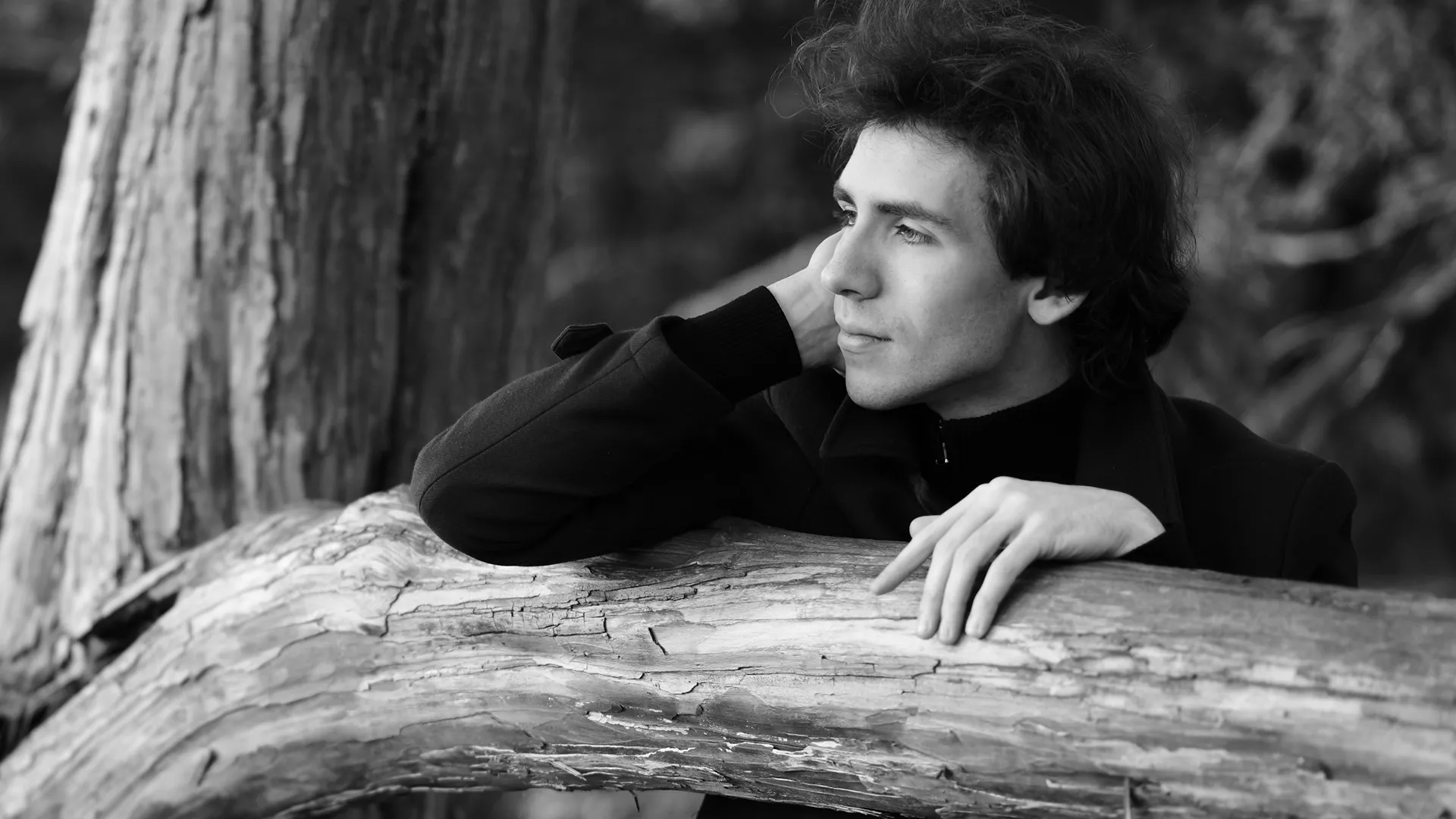 Rencontre
RencontreAvant-concert : Rencontre avec Alexandre Kantorow
De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’un moment privilégié à la fois intime et…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0016mai2024__8 € -
 Rencontre
RencontreAvant-concert : Rencontre avec Eva Ollikainen
Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CMercredi 19h0025septembre2024_ -
 Rencontre
RencontreAvant-concert : Rencontre avec Dima Slobodenious
Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0026septembre2024_ -
 Rencontre
RencontreAvant-concert : Rencontre avec Olivier Latry et Pascal Dusapin
Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0003octobre2024_ -
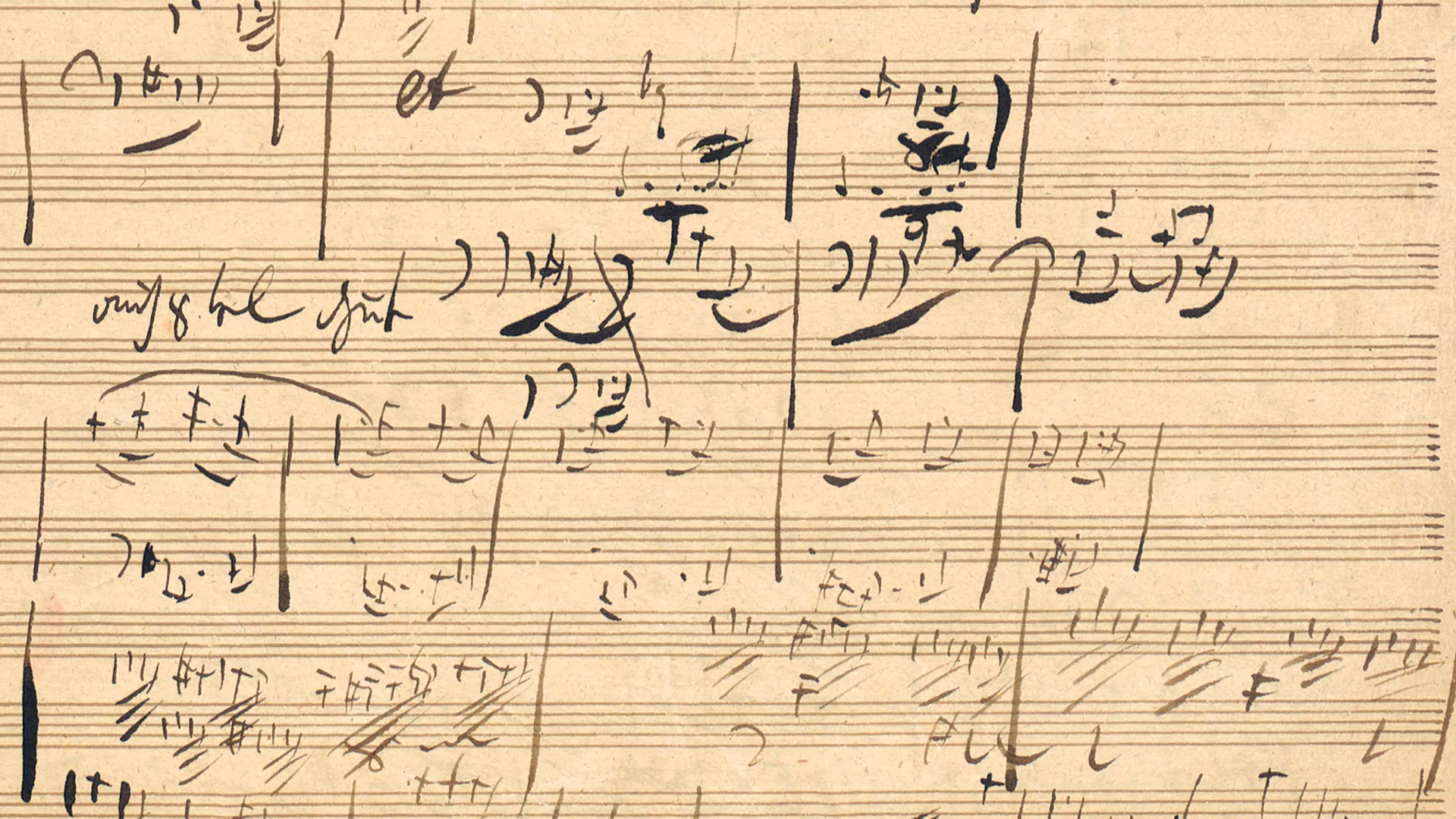 Rencontre
RencontreAvant-concert : Présentation de l’original du manuscrit de l’Apprenti Sorcier de Paul Dukas
Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0028novembre2024_ -
 Rencontre
RencontreAvant-concert : Rencontre avec Sofi Jeannin
Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CMardi 19h0010décembre2024_ -
 Rencontre
RencontreAvant-concert : Rencontre avec Tarmo Peltokoski
Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0016janvier2025_ -
 Rencontre
RencontreAvant-concert : Rencontre avec Irvine Arditti
Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CMercredi 19h0005février2025_ -
 Rencontre
RencontreAvant-concert : Rencontre avec Pablo Heras-Casado
Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0013février2025_ -
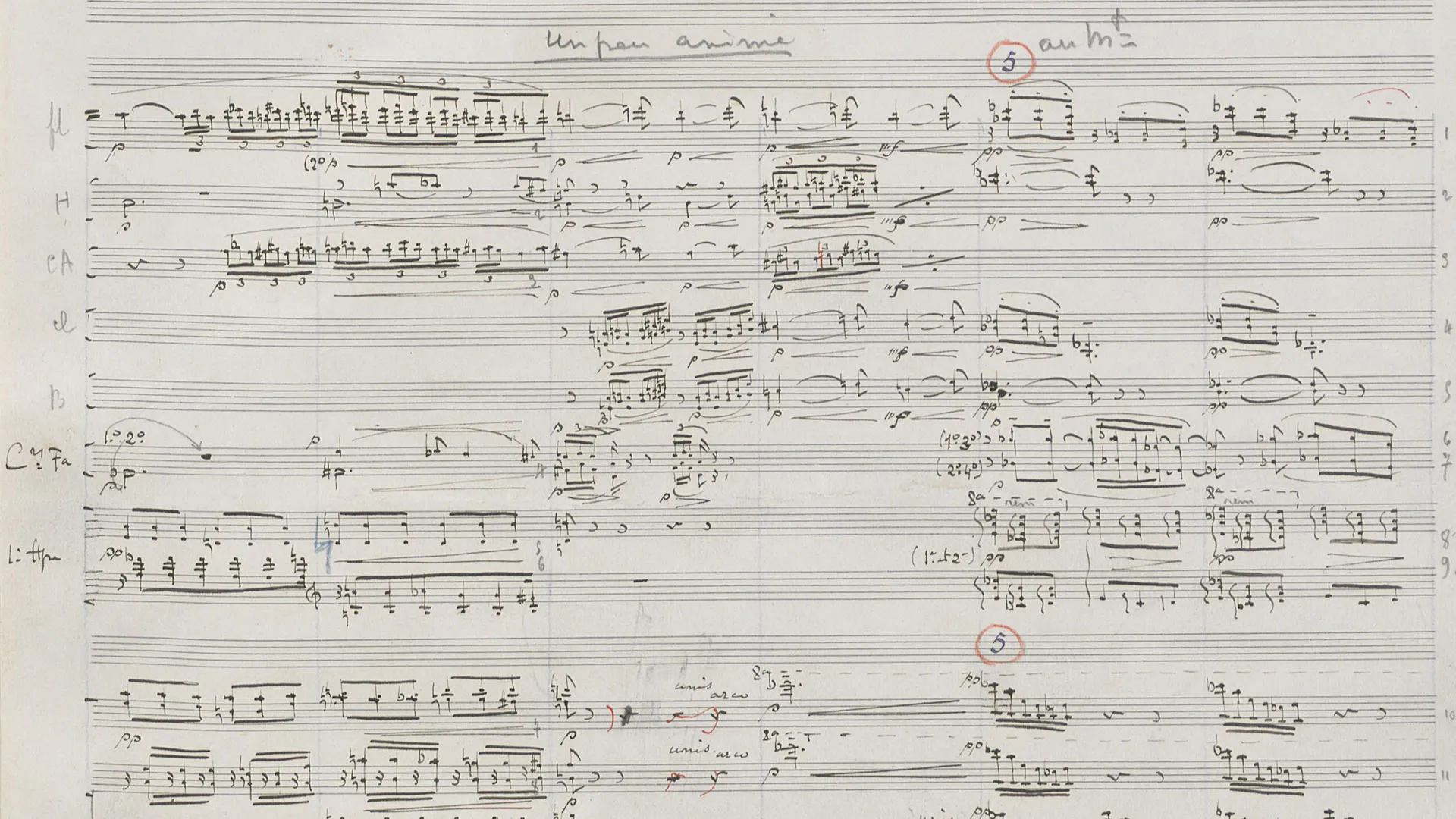 Rencontre
RencontreAvant-concert : Présentation de l’original du manuscrit de La Valse de Maurice Ravel
Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0013mars2025_ -
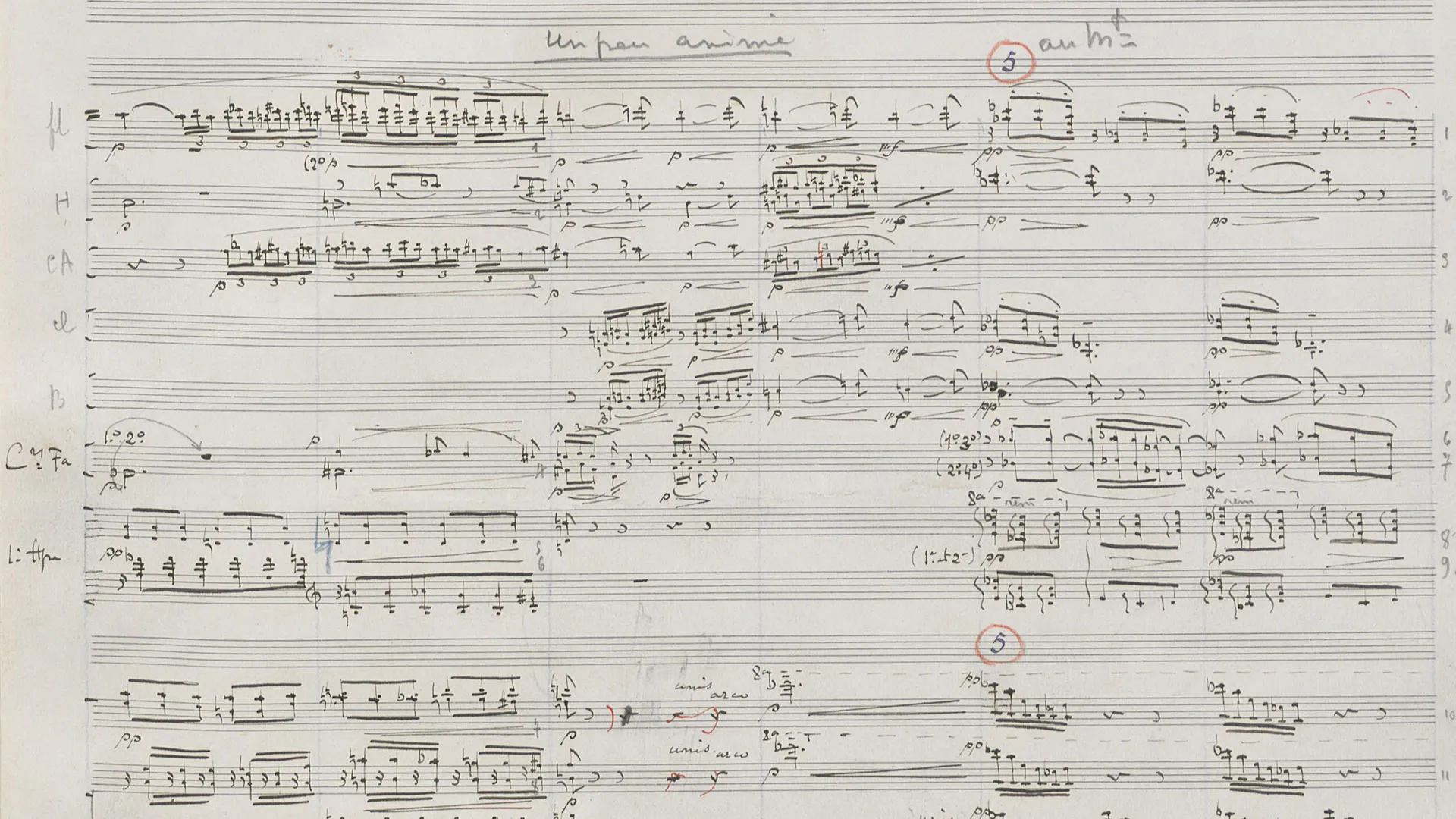 Rencontre
RencontreAvant-concert : Présentation de l’original du manuscrit de la Symphonie n°82 «L’Ours» de Joseph Haydn
Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CMercredi 19h0002avril2025_ -
 Rencontre
RencontreAvant-concert : Rencontre avec Kristiina Poska
Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0010avril2025_


