Titre
En ce moment
Titre
En ce moment
Sous-titre
Changement de chef ou de soliste, brève nouvelle, anecdote ou fait d'importance dans l'univers de la musique à la Maison de la Radio et de la Musique, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas !
Vue
Actualités

Viole de gambe 2.0
Portrait d'Eva Reiter
Une main dans la viole de gambe, l'autre dans l'électronique. Entre érudition et fureur…

Quand la parole lyrique est à l’acteur
Cet hiver, le cinéma donne de la voix à Radio France, des épopées de John Williams aux BO de…

Le Théâtre des Salins à Martigues
Rendez-vous le 8 janvier 2026 dans les Bouches-du-Rhône à Martigues pour la 5ᵉ escale du Grand Tour…

Les inconnus dans la maison

« À la radio, j’aime quand l’auditeur sent qu’on lui parle vraiment »
Rencontre avec Suzanne Gervais de France Musique
Journaliste, productrice, autrice de podcasts et voix familière des auditeurs de France Musique,…
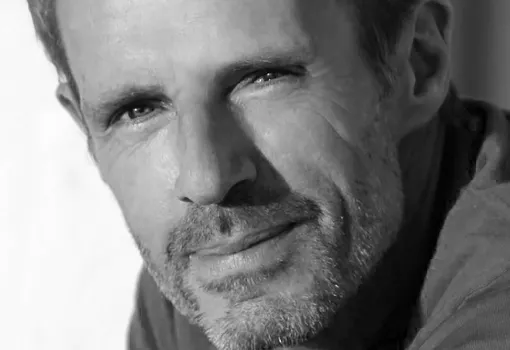
Trois questions à Lambert Wilson
Après Le Roi David cet automne, le comédien et chanteur retrouve l’Auditorium de Radio France le 30…

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Paradis
C’est avec le plus atypique des oratorios de Schumann que Philippe Jordan fait son retour à la tête…

Dans l’ombre de la gloire
Admiré de ses pairs et régulièrement salué par la critique, Frank Peter Zimmermann trace depuis…

Les sens de Rachmaninov
Difficile d’évoquer Sergueï Rachmaninov sans céder à la tentation du romanesque : un aristocrate en…

Santons tous en chœur !
Tambourins, pastorales et airs d’antan résonnent sous la lumière du Midi : la Maîtrise de Radio…

Magnolias para siempre
Avec Bizet, Rodrigo et même Rimski-Korsakov, l’Orchestre National de France passe la nouvelle année…

Les Anglais parlent (musique) aux Français
Sous la baguette de John Eliot Gardiner et de Stephen Layton, l’hiver de la Maison de la Radio et…

